Précieux hussards

Quand je monte dans la voiture, au petit jour, le lundi 17 octobre, je suis contente, après un très bon weekend, parfaitement dosé en dédicaces, représentations, moments partagés de rire, d'émotion, verres de l'amitié et petits plats mijotés à la perfection par l'ami Jacques, maître queux de la Fontaine d'Argent et compagnon de Fabienne, la belle patronne du, d'après la légende, plus ancien café-théâtre de France, si l'on excepte le mythique et parisien Café de la Gare. La vie comme je l'aime.
 Reste, avant le TGV de retour vers Paris, à mener à bien le dernier acte de mon séjour provençal. Une rencontre en milieu scolaire est prévue. Non pas en lycée, voire collège, comme j'en ai l'habitude, mais en primaire, avec des CM1 et CM2. L'organisateur s'appelle Jean-Rémi Barland. Il est correspondant de presse et chronique pour La Provence les romans qu'il dévore. Je lui dois, dès sa sortie, un très laudateur papier sur "JeMourraiUneAutreFois", ce qui me pousse, vous savez ce que c'est, à le trouver à la fois sympathique et compétent. Il est aussi instituteur, et c'est à ce titre qu'il a organisé la rencontre. Samedi, il m'a dit: "Tu verras, ils ont préparé un spectacle, pour toi". Pour dire la vérité, soyons honnête, les spectacles joués par des enfants, j'en ai beaucoup mangé à une époque de ma vie, et je m'y suis toujours ennuyée comme s'ennuient ceux des spectateurs qui ne sont pas les parents des artistes d'un jour... Mais bon, ça part d'un bon sentiment, c'est gentil, et les enfants m'intéressent toujours, alors allons-y gaiement !
Reste, avant le TGV de retour vers Paris, à mener à bien le dernier acte de mon séjour provençal. Une rencontre en milieu scolaire est prévue. Non pas en lycée, voire collège, comme j'en ai l'habitude, mais en primaire, avec des CM1 et CM2. L'organisateur s'appelle Jean-Rémi Barland. Il est correspondant de presse et chronique pour La Provence les romans qu'il dévore. Je lui dois, dès sa sortie, un très laudateur papier sur "JeMourraiUneAutreFois", ce qui me pousse, vous savez ce que c'est, à le trouver à la fois sympathique et compétent. Il est aussi instituteur, et c'est à ce titre qu'il a organisé la rencontre. Samedi, il m'a dit: "Tu verras, ils ont préparé un spectacle, pour toi". Pour dire la vérité, soyons honnête, les spectacles joués par des enfants, j'en ai beaucoup mangé à une époque de ma vie, et je m'y suis toujours ennuyée comme s'ennuient ceux des spectateurs qui ne sont pas les parents des artistes d'un jour... Mais bon, ça part d'un bon sentiment, c'est gentil, et les enfants m'intéressent toujours, alors allons-y gaiement ! Et je me prends une claque. Parce que Jean-Rémi n'est pas un metteur en scène à la mode, ni un chorégraphe habité, ni rien de tout ça. Il est un pédagogue, un vrai. Un de ces êtres qui prennent les enfants par la main, pas seulement le temps d'un refrain à la Duteil, mais toute l'année, pendant des années et pour la vie...
Et je me prends une claque. Parce que Jean-Rémi n'est pas un metteur en scène à la mode, ni un chorégraphe habité, ni rien de tout ça. Il est un pédagogue, un vrai. Un de ces êtres qui prennent les enfants par la main, pas seulement le temps d'un refrain à la Duteil, mais toute l'année, pendant des années et pour la vie...La salle a été dégagée, des bancs en font tout le tour. Au fond, Jean-Rémi s'active à la sono. J'entends les premières mesures de L'estaca, la chanson de Luis LLach. Une chanson que je peux pas entendre sans que mon coeur se serre. Aux heures noires de la dictature, cette chanson catalane, qui ne mentionne ni la politique, ni la dictature, et grâce à cela mit un certain temps à être repérée par la censure franquiste, fut perçue et reprise pour ce qu'elle était, une incitation à l'union, à la résistance et à la lutte...
Les enfants entrent, s'assoient, disent bonjour et ça commence. Parfaitement vif et rythmé. Le rythme, piège premier des représentations enfantines, est déjoué d'entrée. On sent l'entrainement. Chaque enfant a appris une phrase, ou un morceau de phrase, et chacun son tour, pas dans l'ordre où ils sont assis, mais dans un ordre apparemment aléatoire, sans temps mort. Le texte prend vie et relief, se met à rebondir d'un mur à l'autre, les mots jouent, se répondent, se croisent, et ma gorge se noue. J'ai reconnu le dernier chapitre de l'Exil est mon pays, et c'est comme si je l'entendais pour la première fois:
"Mon vrai pays n’est pas fait de terre, de paysages, de montagnes et de rivières. Vous n’y trouverez pas de villages avec des grands-mères dedans, et pas de cimetières pleins d’ancêtres protecteurs. Mon pays est fait des rêves de mes parents, de souvenirs qui leur font tellement mal qu’ils ne savent qu’en plaisanter, de routes encombrées dont on ne sait pas où elles vont, et du sentiment permanent d’être une personne déplacée. Mon passeport indique clairement ma qualité de citoyenne de la République Française, membre de l’Union Européenne. Le laissez-passer que j’ai dans le cœur pleure un paradis perdu. Dans le train qui avance à reculons, je me suis découvert des millions de compatriotes. Apatrides, cosmopolites, persécutés, expulsés, arrachés, déracinés, émigrés, réfugiés, transplantés, greffés, rejetés, assimilés, intégrés, digérés, disparus... Je marche aux côtés de tous les vaincus de la terre, chassés par les caïns éternels sur les routes sans fin de la défaite. Ces routes, je n’y ai jamais mis les pieds et quiconque m’observerait, déambulant dans une rue parisienne, humant l’air du temps, guettant d’un œil expert les nouveautés des boutiques, ne verrait qu’une bourgeoise en goguette et un exemple encourageant d’intégration réussie. Les escadrons de l’exil qui campent la nuit dans mon esprit ne sont pas visibles à l’œil nu. J’ai passé des années à les cacher pour faire semblant d’être comme tout le monde. Mais moi je suis du pays des étrangers, des exilés. Les miens. L’exil est mon pays. "
 Je regarde ces enfants. Neuf, dix ans. Filles et garçons. Des fluets, des costauds, des grands, des petits, des fins, des ronds. Des épidermes de toutes les couleurs. La France d'aujourd'hui et surtout, de demain. Combien d'entre eux sont, comme moi, enfants de l'exil, et à combien de générations? Je ne sais pas, mais qu'ils le soient ou pas, ils portent les mots, se les approprient avec la clarté et l'énergie propre à leur âge. Beau cadeau pour une auteure.
Je regarde ces enfants. Neuf, dix ans. Filles et garçons. Des fluets, des costauds, des grands, des petits, des fins, des ronds. Des épidermes de toutes les couleurs. La France d'aujourd'hui et surtout, de demain. Combien d'entre eux sont, comme moi, enfants de l'exil, et à combien de générations? Je ne sais pas, mais qu'ils le soient ou pas, ils portent les mots, se les approprient avec la clarté et l'énergie propre à leur âge. Beau cadeau pour une auteure.Puis ils chantent et j'ai, encore, el corazon en un puño, comme on dit outre Pyrénées, le coeur dans un poing. Ils chantent librement, sans que l'intervention de Jean-Rémi soit visible, sans autre guide apparent que la bande son et leur propre sens de la musique et du collectif. Quand on chante ensemble, il en reste toujours quelque chose. La chanson? "Je me suis barré d'un môme" du grand Romain Didier (paroles d'Allain Leprest). Imaginez les voix toutes neuves, à l'unisson, tantôt retenues, tantôt libérées, presque criées. Magnifique. Le duvet des avant bras se met au garde-à-vous.
Deuxième passage de "L'Exil est mon pays":
 "En inventant le western, Hollywood a transcendé des gardiens de vache en tragédiens. Question de présentation. Les cow-boys ont offert à des cohortes de déracinés le mythe qui les légitime. Sans western, pas d’Amérique. Grâce à maman, nous avions notre Hollywood à nous. Elle ne cherchait pas juste à nous distraire. En puisant dans les chapitres véridiques de la légende familiale, elle levait patiemment une digue de résistance au mépris et à la condescendance que le regard des gens nous servait en plat du jour. Elle nous inculquait mine de rien la fierté d’appartenir à une lignée qui ne renonçait ni à sa liberté ni à ses rêves. Les autres nous voyaient comme des moins que rien, mais dans ses yeux, nous valions plus que tout."
"En inventant le western, Hollywood a transcendé des gardiens de vache en tragédiens. Question de présentation. Les cow-boys ont offert à des cohortes de déracinés le mythe qui les légitime. Sans western, pas d’Amérique. Grâce à maman, nous avions notre Hollywood à nous. Elle ne cherchait pas juste à nous distraire. En puisant dans les chapitres véridiques de la légende familiale, elle levait patiemment une digue de résistance au mépris et à la condescendance que le regard des gens nous servait en plat du jour. Elle nous inculquait mine de rien la fierté d’appartenir à une lignée qui ne renonçait ni à sa liberté ni à ses rêves. Les autres nous voyaient comme des moins que rien, mais dans ses yeux, nous valions plus que tout."Les textes se succèdent, les chansons aussi, je ne sais plus dans quel ordre, mais en alternant légèreté et émotion. Il y aura deux extraits de "Je mourrai une autre fois"
L'éventail de Nena:

" Nena n’aime que les belles choses : – La beauté est un droit de l’Homme, comme la liberté et la justice! Elle porte de la soie parce que c’est bon pour la peau. Elle chante des coplas pour nous régaler de sa voix. Elle aime aussi le café, le chocolat et les fleurs. Et elle adore son reflet dans les miroirs, nombreux, qu’elle accroche parmi les tableaux, et un peu partout dans l’appartement, le commente avec ravissement : – Tant qu’on garde le front bombé et les joues rondes, c’est que l’enfance n’est pas morte... (...) De même que décrire mon père sans son journal donnerait de lui une image tronquée, ce serait mutiler ma mère que de ne pas mentionner l’élément dissociable de son corps mais pas de sa personne. Tel un chef d’orchestre avec sa baguette, Nena ponctue ses paroles avec son éventail, le premier de ses bijoux, toujours dans sa main ou à proximité. Conçu pour rafraîchir quand la chaleur pèse, l’instrument est devenu, en toute saison, le prolongement de son éloquence. À mesure qu’elle l’ouvre, trrt, le ferme, trrrt, bat la mesure, tactac, le tape contre ses sautoirs, tictictic, il dessine dans l’air des points d’exclamation, de suspension, des guillemets, des parenthèses..."
Ou les grèves des Asturies:
 "La Révolution d’Octobre dans les Asturies n’aura duré que quelques jours. Mais elle n’a jamais cessé d’étinceler dans ma mémoire. Parce qu’un peuple humilié qui décide de son destin, qui prend les armes, se lève et se bat, reste ce que le monde fait de plus beau, de plus grand. De plus digne. Une semaine de lutte des humiliés brille pour toujours dans les ténèbres, et pèse davantage que les années de résignation qui l’ont précédée. Elle éclaire, elle guide, voie lactée, rivière de diamants, appelez ça comme vous voulez, on reste dans le lumineux, l’inaltérable. (...). Mais personne ne renoncerait à une seule heure, une seule minute de ces jours-là, où rêves et courage ne firent qu’un, parce qu’on s’est senti libre. Vivant. Entier. Humain."
"La Révolution d’Octobre dans les Asturies n’aura duré que quelques jours. Mais elle n’a jamais cessé d’étinceler dans ma mémoire. Parce qu’un peuple humilié qui décide de son destin, qui prend les armes, se lève et se bat, reste ce que le monde fait de plus beau, de plus grand. De plus digne. Une semaine de lutte des humiliés brille pour toujours dans les ténèbres, et pèse davantage que les années de résignation qui l’ont précédée. Elle éclaire, elle guide, voie lactée, rivière de diamants, appelez ça comme vous voulez, on reste dans le lumineux, l’inaltérable. (...). Mais personne ne renoncerait à une seule heure, une seule minute de ces jours-là, où rêves et courage ne firent qu’un, parce qu’on s’est senti libre. Vivant. Entier. Humain."Les chansons:
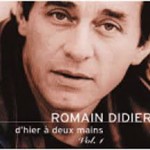 Madame Untel (Live) de Romain Didier
Madame Untel (Live) de Romain DidierSur mon chemin de mots, Écrire pour ne pas mourir, Une sorcière comme les autres, de Anne Sylvestre.
Les émigrants de Bruno Brel
Certains de ces textes sont graves, sérieux. Les enfants comprennent parfaitement ce qu'ils disent. Un travail patient, attentif, a mis à leur portée le sens et les intentions, comme par un pantographe qui réduit mais ne dissimule rien. On sent le travail, le talent, la subtilité du pédagogue. Les voix d'enfant, sincères et fraîches, ripolinent les mots, les transcendent. Et l'émotion paroxyse. Je tente de ne pas laisser paraître à quel point je suis touchée.
Puis on me passe à la question. Une par un, ils se lèvent, se présentent, ribambelle bigarrée de prénoms de maintenant. Des traditionnels, des à la mode, des exotiques, des inventés. Encore la France d'aujourd'hui, et surtout de demain. France des choix ouverts et des libres couleurs. Ils veulent tout savoir. Pourquoi, quand, comment, à quelle heure, avec quoi, où j'écris... Et pourquoi le spectacle, et pourquoi le féminisme... Je me régale. Eux aussi, apparemment.
On finit par une photo de groupe. Ils veulent des selfies, ils veulent des bisous, ils rient, ils crient et Jean Rémi, point d'ancrage, arbitre, guide, calme le jeu. Nous avons tou-te-s un-e instit inoubliable, qui a su nous faire avancer. Gageons que Jean-Rémi restera dans la mémoire et le coeur de ses écoliers.

Je remonte en voiture, touchée, pensive. Je viens de voir à l'oeuvre un instituteur. Un héritier de ceux que Péguy baptisa "hussards noirs de la République" et décrivit ainsi : "Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs. Sveltes, sévères, sanglés. Sérieux, et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence" ( l'Argent, 1913) Les hussards noirs avaient une vraie mission: instruire le peuple. Ils exercent depuis 1833, rejoints par les institutrices en 1879. Quarante six ans il a fallu pour admettre que les filles aussi... Ce matin, aux cotés de Jean-Rémi, une de ces héritières des pionnières d'antan, Francine Rizzon, est venue prêter main forte et sourire. Merci à elle.
On dit aujourd'hui professeur des écoles, parce que les précieux ridicules ne baissent jamais la garde. Pourtant, institutrice ou instituteur, le mot est beau, la mission magnifique, l'institution précieuse. Et perfectible, oui. Comme énormément de choses. Mardi matin, sur France Inter, j'entends Sarko parler des enseignants qui "ne bossent que six mois par an". Et je l'entends reprendre la litanie des fonctionnaires flemmards, parasites, profiteurs en vacances perpétuelles. Tout ce que la République a construit pour le bien commun est aujourd'hui miné, saboté par ceux qui aimeraient privatiser les services publics une fois pour toutes et diversifier les sources de foutage-plein-les-poches. Mais il y a des choses non privatisables. Comme, par exemple, les valeurs de partage et de solidarité qui menèrent à la création de ces services pour tous. La prochaine fois qu'il prend à Sarko l'envie de tenir des propos indignes, qu'il vienne faire un tour dans le Sud, chez Jean-Rémi, chez Francine, chez les enfants multicolores. Chez nous.
